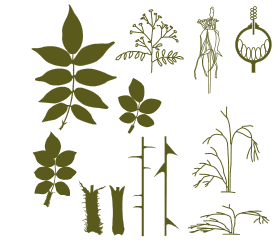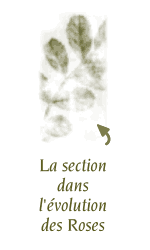|
La section des Synstylae (sous-genre Eurosa) Exemples: R. arvensis, R. brunonii, R. multiflora, R. phoenicia, Morphologie
Habitat Plantes de lisières ou de fourrés, appréciant une végétation environnante dense et parfois la présence de l'eau courante. Géographie À l'opposé
des Cinnamomeae, ces roses se rencontrent plutôt dans les
régions méridionales, avec le plus au nord notre "rosiers
des champs" Exemples et llustrations La "rose musquée de l'Himalaya" (R. brunonii Lindl.) Rosa brunonii se rencontre depuis l'Afghanistan jusqu'à la Chine en longeant le versant sud de l'Himalaya. Ses populations les plus occidentales, des montagnes de l'ancienne Perse ont peut-être donné naissance à la rose musquée anciennement cultivée en Europe, qui n'est connue que des jardins et aurait été introduite dans le bassin méditerranéen par les Arabes. Illustration: John Lindley, Rosarum Monographia, 1820, pl. 14; bibliothèque, et avec l'autorisation du Jardin botanique national de Belgique.
Dans cet ouvrage sont réunies la description de cette nouvelle espèce et sa première illustration. La "rose de Phénicie" (R. phoenicia Boiss.) Herbier: collecté par P. Sintenis, Iter Trojanum 1883, Paspaly, in dumetis, 12/6, N°969; herbier Crépin.
Le botaniste prussien Paul Ernst Emil Sintenis (1847-1907) a consacré une grande partie de sa vie à des expéditions destinées aux récoltes botaniques. Celles-ci étaient souvent financées par des souscriptions. De son voyage dans la Troade (région de Troie, à l'extrême ouest de la Turquie), il ramena ce spécimen typique de la rose de Phénicie. À l'état
sauvage cette rose se rencontre au nord de l'ancien croissant fertile
mésopotamien, dans une région parcourue durant des
millénaires par les migrations humaines. On la trouve principalement
au Liban (anciennement la Phénicie), en Syrie, au nord d'Israël,
un peu au nord-est de l'Irak et dans le sud et l'ouest de la Turquie.
Elle recherche en général les climats chauds à
proximité des eaux et à faible altitude.
Bien que rare en culture en Europe (elle résiste mal au froid) elle a eu une influence très importante sur les premières races est méditerranéennes et européennes de roses cultivées sans doute déjà avant le début de notre ère. Selon Hurst, on retrouvait de sa sève via les roses de Damas dans les roses à cent feuilles, les roses Bourbon, les hybrides remontants et tout ce qui en descend. Si la présence de ses gènes n'est pas citée par Hikaru Iwata dans la parenté qu'il attribue aux Damas d'après ses expérimentations génétiques, elle se retrouve apparemment dans R. gallica var. officinalis et la morphologie des centfeuilles et des Portlands laisse entrevoir son influence. De plus, certaines de ses formes (locales peut-être) sont naturellement remontantes. |
|||||||
| © ivan louette et Commune de
Chaumont-Gistoux, 2005. Reproduction électronique autorisée moyennant mention de la source. Republication papier autorisée, aux conditions suivantes. Ni la Commune de Chaumont-Gistoux, ni les personnes agissant en son nom ne peuvent être tenues responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations diffusées sur ce site Web. |