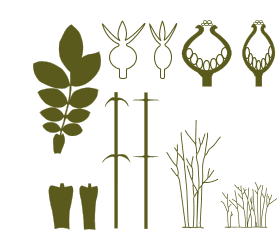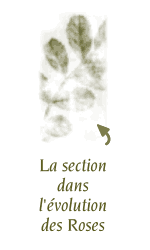|
La section Cinnamomeae (sous-genre Eurosa) Exemples: R. majalis, R. pendulina, R. multibracteata, R. moyesii, ... Morphologie
Habitat Rosiers souvent liés à une atmosphère humide et fraîche, que celle-ci soit occasionnée par une exposition à des vents dominants humides, ou par la proximité des sources, le confinement au milieu d'autres végétaux sur sol frais. Géographie Présente dans l'hémisphère nord (il n'y a pas de rosiers spontanés dans l'hémisphère sud) sur tous les continents excepté l'Afrique semble-t-il. On rencontre des rosiers de cette section jusqu'au-delà du cercle polaire arctique (R. acicularis). Exemples et llustrations La rose de mai (R. majalis Herrm.) Le nom de cette rose lui vient de sa floraison hâtive, en mai. Elle est également
appelée "rose cannelle" (R. cinnamomaea
L.)
À l'état sauvage, la rose de mai se rencontre de l'Europe du nord (ou plus au sud en altitude dans des lieux humides) à la Sibérie. Herbiers: Collection Martinis, herbier Crépin.
La provenance
exacte de ces spécimens n'est malheureusement pas spécifiée.
Ils ont été extraits par Crépin de la collection
d'herbiers Martinis, un fonds important des collections d'herbiers
du jardin botanique national. Illustration: John Lindley, Rosarum Monographia 1820, pl. 5 (sous l'appellation Rosa cinnamomaea); bibliothèque et avec l'autorisation du Jardin botanique national.
|
|||||||
| © ivan louette et Commune de
Chaumont-Gistoux, 2005. Reproduction électronique autorisée moyennant mention de la source. Republication papier autorisée, aux conditions suivantes. Ni la Commune de Chaumont-Gistoux, ni les personnes agissant en son nom ne peuvent être tenues responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations diffusées sur ce site Web. |